Prodiges et vertiges de l'analogie
de l'abus des belles-lettres dans la pensée
Deze auteur verdiept zich in de filosofie, zoals blijkt uit zijn academische carrière. Zijn werk richt zich op de analyse en ontwikkeling van filosofische ideeën. Door zijn aanstellingen aan vooraanstaande universiteiten heeft hij generaties studenten gevormd en bijgedragen aan een dieper begrip van filosofische concepten. Zijn intellectuele nalatenschap ligt in doordachte reflectie op kernvragen van het denken.

![Das XX. [zwanzigste] Jahrhundert](https://rezised-images.knhbt.cz/1920x1920/72587899.jpg)
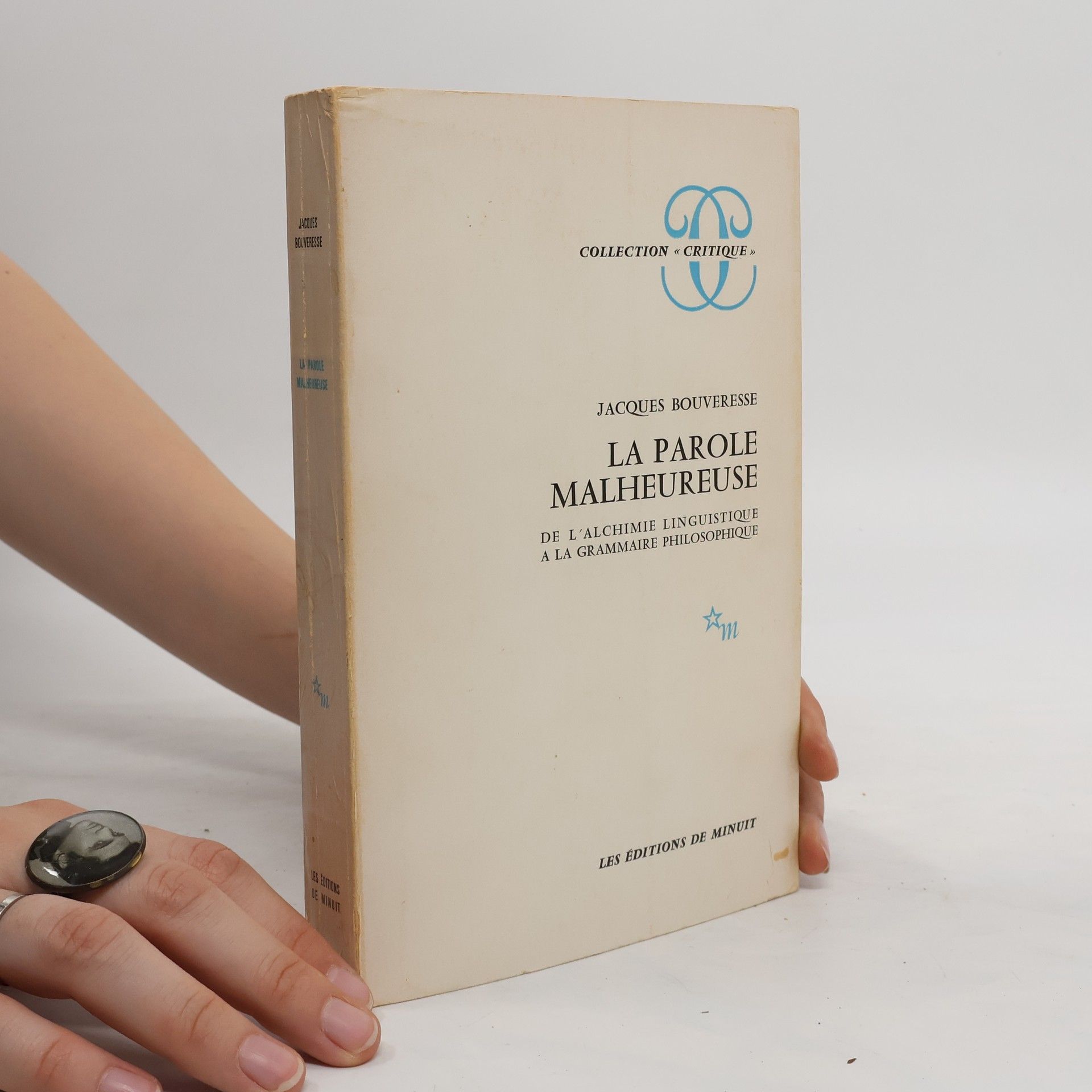
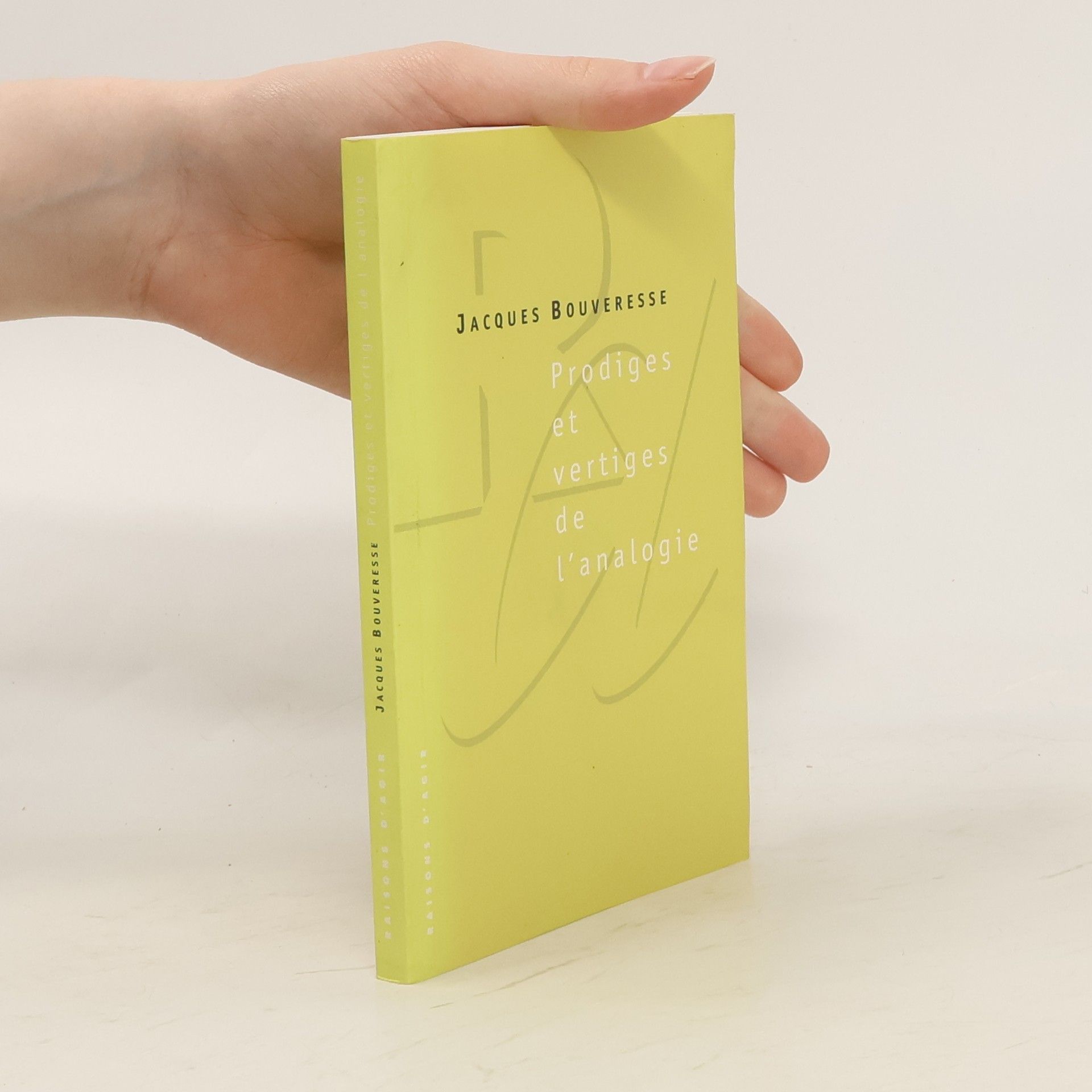
de l'abus des belles-lettres dans la pensée
Il est impossible de formuler des propositions philosophiques en général : c'est une conviction sur laquelle Wittgenstein n'a jamais varié. La solution réelle et complète d'un problème philosophique ne consiste pas pour lui à remplacer un usage métaphysique du langage par un autre, mais à ramener les mots de leur usage métaphysique à leur usage ordinaire. Cette idée constitue la véritable originalité de Wittgenstein. Le chemin qu'il nous suggère d'emprunter, c'est justement celui qui a été oublié par le système des options philosophiques existantes. À la différence de beaucoup de travaux antérieurs, les textes de ce recueil se caractérisent par le fait que leurs auteurs acceptent tous d'essayer de jouer le jeu de la philosophie à la façon de Wittgenstein. JACQUES BOUVERESSE. Les treize contributions ici réunies sont principalement consacrées au Wittgenstein des dernières années (1946-1951). Après l'époque du Tractatus, puis celle des Recherches philosophiques, sa pensée prend alors des inflexions nouvelles. Les manuscrits de cette période sont un matériau d'une richesse considérable, encore insuffisamment exploré. Ce livre a pour origine un colloque intitulé " Le dernier Wittgenstein " qui s'est tenu au Collège de France du 14 au 16 mai 2001, organisé par Jacques Bouveresse, Sandra Laurier et Jean-Jacques Rosat.